Depuis 15 ans, avec l’association Yahad in Unum dont il est le président, le père Patrick Desbois collecte des milliers de témoignages pour conserver la mémoire des deux millions de Juifs assassinés par les nazis de 1941 à 1944 sur les territoires de l’Union Soviétique occupée. Il vient de publier “La Shoah par balles” (Plon).
Campagne de soutien 2025
Ce contenu est gratuit, comme le sont tous nos articles.
Soutenez-nous par un don déductible de l’impôt sur le revenu et permettez-nous de continuer à toucher des millions de lecteurs.
Aleteia : Dans quelles conditions s’est déroulée l’enquête dont votre dernier livre est l’aboutissement ?
Père Patrick Desbois : Notre équipe de 29 personnes a sillonné une dizaine de pays différents et filmé 7.000 témoignages. Nous avons voulu déterminer quel était le plus grand dénominateur commun entre des massacres de natures très diverses, qu’ils impliquent quelques victimes ou des milliers. Je soupçonnais l’existence d’une méthode du crime sous l’apparence artisanale et aléatoire. Nous avons été confrontés à de nombreuses énigmes transversales. Comment choisissait-on les villages et les jours des exécutions ? Pourquoi les Allemands arrivaient-ils systématiquement entre 05H00 et 06H00 du matin ? Qui était l’homme, celui que j’appelle l’architecte, qui venait en avance pour déterminer où creuser la fosse et quelles dimensions lui donner ? Comment parvenait-on à assassiner autant de gens en moins d’une journée ? Comment fonctionnaient les réquisitions ?
Vous dites souvent que vous écrivez la « micro-histoire » de la Shoah…
Il est très différent de considérer un génocide depuis un satellite, un avion ou, effectivement, depuis une cour de ferme. Mon approche est parfois contestée par des historiens qui ne sont pas toujours à l’aise car dans une cour de ferme toute vision globalisante devient difficile. Mais la situation a beaucoup changé. La micro-histoire contredit parfois totalement la grande histoire. Faut-il la cacher pour autant ?
Un des aspects saisissants de votre travail, c’est l’articulation étroite entre les tueurs allemands et les populations locales…
Mon approche s’intéresse à une catégorie qui échappe souvent aux études sur le génocide : les voisins. Dans les territoires occupés de l’URSS, comme il n’y avait pas de camps, ce sont les voisins qui tiraient les fils barbelés. Dès lors, nous avons dû nous plonger dans la vie quotidienne des Soviétiques pour comprendre. Il nous a fallu l’expertise de spécialistes qui puissent nous expliquer le rôle des starostes, des soltous ou des desiatnik, tous ces rouages hétérogènes de l’administration soviétique, difficilement comparables à nos fonctionnaires municipaux, qui ordonnaient les réquisitions ou recrutaient les Polizei, les auxiliaires de police locaux associés à la plupart des massacres.

Lire aussi :
Le père Manfred Deselaers a choisi de vivre à Auschwitz
Ces voisins, que vous avez interviewés, ont souvent participé de près ou de loin aux tueries. Et pourtant ils nous ressemblent par bien des aspects.
J’ai vu en Ukraine un homme qui travaillait dans une gare et dont le travail consistait à apporter des escabeaux pour que les Juifs puissent grimper dans des trains dont l’accès était trop haut pour eux. Dès que les Juifs arrivaient, il accomplissait sa tâche. C’est tout. Cette humanité-là, ambivalente, nous gêne car elle nous ressemble. Ce qui n’atténue en rien la responsabilité de celui qui accomplit le travail de base. La femme, aujourd’hui très âgée, qui a comblé des fosses dans lesquels des Juifs étaient encore vivants, je ne la considère pas comme négligeable. L’homme ordinaire, venu de Munich, où il a laissé sa famille, et qui un matin finit par tuer 300 personnes, je ne le considère pas comme le dernier écrou de la machine. Il faut revaloriser la responsabilité des petites gens dans le crime. Ils sont trop bas dans l’échelle pour avoir été jugés, mais à la fin, ce sont eux qui tuent.
Avez-vous pu mettre à jour la chaîne de commandement ?
C’est extrêmement difficile. Les états-majors des Einsatzgruppen (unités de police militaire qui suivaient l’avancée des troupes allemandes pour éliminer les éléments jugés indésirables par le Reich comme les Juifs ou les tziganes, ndlr) étaient mobiles et l’organisation très décentralisée. Les autorités locales ont joué un rôle capital dans la mécanique génocidaire. Certes, Himmler est omniprésent dans les archives. Des noms se distinguent comme celui de Blobel — responsable de l’extermination de Babi Yar, en Ukraine — ou encore celui de Jeckeln, qui commande la police. Mais ce ne sont pas eux qui arrivent dans les villages. Nous avons eu la plus grande peine à identifier certains responsables anonymes, comme cette femme repérée à plusieurs reprises dans des lieux différents, qui venait empoisonner en amont les enfants pour qu’ils ne ralentissent pas les fusillades.

Pourquoi les nazis ont-ils pu opérer si facilement et dans de telles proportions ?
Sans le système soviétique de la réquisition qui existait antérieurement, les Allemands n’auraient pas pu commettre un crime de cette ampleur. Il leur suffisait de réclamer 70 creuseurs de fosse en arrivant dans un village pour en disposer le lendemain matin. La réquisition faisait partie de la vie quotidienne. On pouvait creuser des fosses pour les Juifs un jour et le lendemain partir déblayer de la neige. La population avait été rendue groggy par le système soviétique. Quiconque discutait pouvait être déporté au goulag. Les nazis étaient parfaitement à l’aise dans ce système. Grâce aux Volksdeutsche, ces germanophones enrôlés dans leurs rangs, ils en connaissaient toutes les arcanes.

Lire aussi :
Envers et contre tous, elle a demandé la grâce de son tortionnaire
Cette succession totalitaire — les staliniens puis les nazis — atténue-t-elle la responsabilité de ces populations ?
Dans le droit soviétique, les réquisitionnés n’étaient pas coupables car ils n’avaient pas le choix. Mais dans les faits, beaucoup d’entre eux étaient ravis car cela leur permettait de voler des vêtements ou de l’or. L’antisémitisme pur n’existe pas. On peut détester les Juifs, mais il est très difficile de tuer des Juifs tous les jours. Himmler le savait, c’est pourquoi il acceptait de surmotiver les assassins en leur donnant une part de butin, soit par le vol, soit par le viol. J’ai constaté des mécaniques comparables lors d’enquêtes récentes en Irak : le viol systématique des filles yézidies a sans doute aidé les djihadistes de Daesh à tenir dans le désert et à commettre les atrocités que l’on connait.
Peut-on parler d’anesthésie morale ?
J’ai pu noter tous les cas de figure. Les combleurs de fosse, par exemple, furent les plus associés au crime. Comme beaucoup de Juifs n’étaient pas morts, ces hommes et ces femmes devaient les enterrer vivants. Un jeune ne l’a pas supporté : alors qu’il était en train de combler une fosse, une main est sortie de la terre et s’est accrochée à sa pelle. La fosse bougeait de partout. Il a perdu connaissance. Inversement, une femme m’a raconté tranquillement, en public, que sa mère comblait aussi les fosses, mais sans que cela ne lui pose de problème de conscience puisqu’elle achevait les survivants à coups de pelle. J’ai découvert une jouissance affreuse. Jouissance de voir et de participer. Jouissance d’avoir été choisi parmi ceux qui peuvent vivre. C’est une part de l’humain qu’on aimerait ne pas connaître. La tentation du crime génocidaire n’est pas un serpent lové dans l’humanité : c’est l’humanité.

Lire aussi :
Saint Maximilien Kolbe, martyr du nazisme
L’athéisme communiste a-t-il pu préparer le terrain en faisant disparaître les armatures morales ?
Ce qui restait du christianisme est difficilement présentable sous un jour positif. Beaucoup des civils qui assistaient aux exécutions, pensaient assister au Jugement Dernier. Ils mettaient de beaux habits et cherchaient une bonne place. Les Juifs, gardés par des étrangers, mourraient au milieu des chrétiens : c’était l’inverse du Chemin de Croix, la vengeance de Dieu et pour beaucoup le signe de la fin des temps. Mais au cours de nos enquêtes, nous avons aussi vu beaucoup de chrétiens prier sur des fosses communes ou les fleurir.
Soixante-quinze ans après, comment peut-on vivre dans ces petites villages, avec tant de non-dits ?
C’est un traumatisme enfoui. Comme un petit film bloqué dans la tête. Les personnes vivent comme si elles n’y pensaient pas. Mais il suffit d’entrouvrir une porte pour que les souvenirs surgissent. Beaucoup de témoins doivent interrompre les interviews car ils se mettent à sangloter. D’autres doivent prendre des pilules pour le cœur car ils font des malaises. Mais ceux qui parlent ont parfois rencontré une grande hostilité dans leurs entourages et il leur a fallu du courage pour témoigner.

Comment fait-on pour interroger des assassins, même devenus des vieillards ?
Les assassins sont centrés sur eux-mêmes et soucieux de leurs personnes. Si on leur parle de leurs victimes, ils s’en fichent éperdument. Par conséquent, si on veut les amener à s’exprimer, il faut réussir à adopter leur regard et à s’intéresser à leurs « problèmes ». Un jour, j’ai interviewé quelqu’un qui avait tué 223 Juifs. Ce qui l’avait marqué, c’était le poids de sa mitrailleuse. « Elle était lourde, elle était lourde. On était deux et on n’y arrivait pas », répétait-il. Seul un souvenir technique très précis lui permettait d’évaluer le nombre de ses victimes : il avait utilisé trois boîtes de cent cartouches. Ce sont ces mêmes tueurs qui vous raccompagnent à la porte de chez eux en vous offrant une panière de fruits et en vous souhaitant longue vie… Quand on sort de là, on est K.O : il est indispensable de connaître ses limites. Le débriefing est indispensable et la psychanalyse précieuse.

Lire aussi :
L’Église face au nazisme en 5 épisodes clés
Comment réagit le prêtre face à ce mal ?
Je vis cela comme un combat. Combat d’autant plus difficile qu’il vous isole car il renvoie à une réalité à laquelle les gens n’aiment pas penser. Je pense toujours au récit du meurtre d’Abel par Caïn : s’il n’avait pas été placé au début de la Bible, personne ne voudrait le lire ! Il faut que les chrétiens osent dire qui tue qui. Jésus a été tué par des gens précis. Qui étaient les gardes ? Quels étaient leurs noms ? Quel était le nom du centurion ? J’aurais aimé avoir un micro au pied de la Croix ! Nous, chrétiens, sommes attendus sur ce domaine. On ne peut pas être le spécialiste de l’amour universel et ne pas affronter le crime permanent.
Arrivez-vous à prier sur les lieux des exécutions ?
Face à une fosse, non. Toutes les paroles sont de trop. Mais la prière demeure indispensable ensuite. Sans elle, sans le silence, sans la méditation des psaumes, je ne pourrais pas continuer. Sans la foi, je n’aurais pas tenu.
Vous arrêterez un jour ?
Ce n’est pas prévu pour le moment…
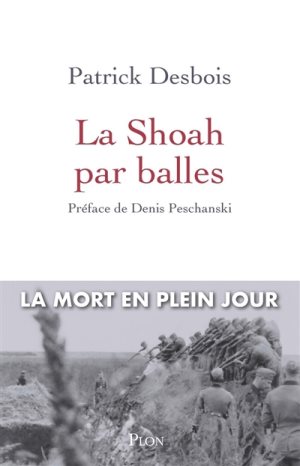
La Shoah par balles, Patrick Desbois, préface de Denis Peschanski, Plon, 328 p., 21,90 euros.



![[HOMÉLIE] Les trois détails intrigants de la parabole du fils prodigue](https://wp.fr.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/6/2025/03/Le-retour-du-fils-prodigue-James-Tissot-Brookly-museum-.jpg?resize=75,75&q=25)




