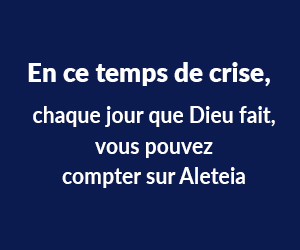Les vacances, plus que toute autre période, font résonner aux oreilles l’impératif hors duquel on est certain de passer pour un rabat-joie austère : “Profite !” Ce qui restait de complément au verbe dans la formule “profites-en bien” tend même à disparaître. Du dépliant d’office du tourisme à l’ami qui vous veut du bien, tous vous le disent : il faut “profiter”. L’emploi absolu du verbe laisse deviner une valeur tout aussi absolue, comme un “jouir sans entraves” qui n’ose plus tout à fait avancer sans masque — héritage incertain de mai 68 oblige —, mais n’est pas prêt pour autant au repentir.
Abuser ou faire des progrès ?
Profiter est donc devenu est forme incontestable du Bien, au point qu’on semble oublier que profiter de la faiblesse d’une personne est a priori moins louable que profiter d’un enseignement. Seul le mot “profiteur” signale encore que le verbe ne désigne pas forcément une activité irréprochable et qu’il peut même cacher des motivations troubles, chaque fois qu’un malotru cherche à “profiter de la situation”. Hors de ce cas, il semble aller de soi qu’aucune vacance ne peut être réussie pour qui n’a pas obéi à l’injonction. “Profite !” signifie peu ou prou “rentabilise au maximum le prix de tes vacances !”, “mange jusqu’à te faire éclater la panse !”, “bois sans craindre ni ivresse ni gueule de bois !”, “oublie toute mesure forcément castratrice !”. En bref, “laisse-toi aller !”, quand ce n’est pas l’insupportable “lâche-toi !” (étant admis qu’il ne serait jamais légitime de se retenir de quoi que ce soit). Si on ajoute que “profiterole” dérive lui aussi de “profit” (il désignait, chez Rabelais, “une petite gratification donnée aux domestiques”), on risque d’entendre plus encore dans le “profite !” un appel à reprendre du dessert sans hésiter, y compris quand on est déjà repu.
Il est amusant de lire dans le Dictionnaire historique de la langue française que le verbe profiter signifiait à l’origine, quand son sujet était un être animé, “faire des progrès, s’améliorer intellectuellement ou moralement”. L’impératif qui vous est adressé avec un sourire complice quand vous partez en vacances n’est pas loin de vouloir dire le contraire : pour profiter, oublie un peu tes préoccupations intellectuelles et tes principes moraux. Le sens tardif du verbe (“tirer le maximum de quelqu’un”) sonne comme un aveu : il se disait parfois dans un sens sexuel, ce qu’on traduirait aujourd’hui par “abuser”. Celui qui vous susurre “profite !” pourrait bien, de fait, vous conseiller à mots voilés d’abuser sans scrupule.
Notre plaisir ailleurs
Après ces considérations, nous nous garderons bien d’adresser un quelconque impératif au lecteur. Nous le laisserons même choisir le sens de “profiter” qui lui convient le mieux pour l’été. Nous citerons toutefois un passage de Proust qui peut lui donner une idée de celui qui a notre préférence, même si, en l’occurrence, c’est l’expression “tirer profit”, un peu moins ambivalente, qui est utilisée. Le narrateur de La Recherche y parle de sa grand-mère :
En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter dont on ne pût tirer un profit intellectuel, et surtout celui que nous procurent les belles choses en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité.
Peut-être de telles grands-mères ne diront-elles jamais explicitement “Profite !”, jugeant un peu vulgaire d’exhiber leurs intentions. Chez elles, en tout cas, affection et désir de faire grandir ne sont jamais séparés. “Notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité” : voilà une pensée dont on peut profiter, sans risque d’abuser.