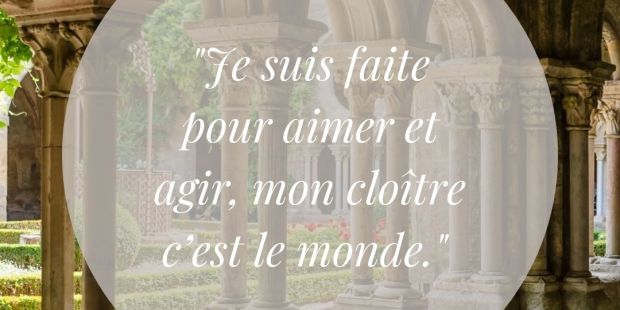Quelle place pour la nature, quelle place pour la grâce ? Quelle efficacité de l’action des hommes, quel rôle de l’action de Dieu ? Si, en principe, tous les catholiques s’accordent sur la nécessité de la coexistence des deux, la question du dosage a provoqué bien des querelles dans l’histoire de l’Église et sous-tend encore bien des controverses. Peut-être est-ce même la toile de fond plus ou moins visible de toutes les disputes, qu’on soit adepte d’”aide-toi le ciel t’aidera” — ce qui masque mal, parfois, un appel à laisser Dieu en dehors de l’affaire — ou qu’on professe un peu vite que “rien n’est impossible à Dieu”, comme un alibi pour ne rien faire soi-même.
Il se peut que les vifs débats qui ont accompagné la privation eucharistique du confinement aient eu leur source en ce même lieu de questionnement : jusqu’où peut-on accepter d’être privé du remède divin par excellence au nom de la prudence humaine ? L’urgence est-elle d’être sauvé de la mort par un vaccin ou du péché par le Christ ? Les deux questions relèvent évidemment de deux ordres différents, mais elles ne peuvent pas être entièrement séparées, puisque la grâce n’abolit pas la nature. En ce sens, il est juste de renvoyer dos à dos deux amputations caricaturales de l’être humain : un matérialisme jugeant qu’il n’a besoin que de pain et de médicaments ; un angélisme estimant qu’il ne vit que de d’hosties et d’absolutions. L’un fait bon marché de l’efficacité sacramentelle ; l’autre tend à oublier que la grâce s’inscrit dans l’incarnation, dont elle est même un prolongement.
Un échange fraternel de Pauline Jaricot et du cardinal Lambruschini, alors secrétaire d’État du pape Grégoire XVI, offre une bonne illustration de cette tension jamais achevée entre guérison divine et remèdes humains. De Rome, juste après avoir été guérie miraculeusement sur la tombe de sainte Philomène à Mugnano, Pauline adresse un mot de soutien à ce cardinal lui-même souffrant : “Les remèdes doivent maintenant céder le pas aux ressources de la foi… De grâce, vénéré Père, employez désormais ces seules puissances si vous voulez être guéri.” À ce conseil dicté par l’enthousiasme de sa guérison miraculeuse, Mgr Lambruschini juge bon d’apporter quelques nuances.
“Une obéissance raisonnable aux médecins est commandée par le Seigneur lui-même.”
Certes, c’est le Seigneur qui guérit, mais, en général, ce Dieu qui passe par les hommes ne néglige pas la médiation médicale : “Le conseil que vous me donnez est bien digne de votre foi. Vous savez cependant, Mademoiselle, que ce ne sont pas les remèdes dont nous faisons usage dans les maladies qui nous guérissent, mais que c’est Dieu seul qui leur donne la vertu pour produire un tel effet quand il veut nous guérir.”
Le cardinal ajoute alors une maxime aussi malicieuse que pétrie de bon sens théologique : “Une obéissance raisonnable aux médecins est commandée par le Seigneur lui-même.” Sans doute Pauline avait-elle besoin qu’on lui rappelât la nécessité du dosage entre la nature et la grâce…
L’effort du patient
À dire vrai, elle ne prônait pas exactement la grâce seule, quand elle prêchait au cardinal “les seules ressources de la foi”. Tout en évacuant la médecine, elle ne négligeait pas une autre action humaine : l’effort du patient. Aussi attendait-elle de Mgr Lambruschini une participation active à l’intervention divine : “J’ai la conviction intime que si votre Éminence est généreuse jusqu’à se refuser un verre d’eau entre les repas, et cela très constamment, Elle aura encore quelques jours de souffrance et de rudes combats à soutenir ; mais après — j’ose lui en donner l’assurance — Elle ne sera plus dominée par la maladie… La vertu de Jésus-Christ peut seule vous guérir.”
S’il est vrai qu’”une obéissance raisonnable aux médecins est commandée par le Seigneur lui-même”, il est tout aussi vrai qu’un médecin raisonnable ne devrait jamais mépriser les remèdes du Seigneur.
Après tout, pourquoi refuser au Christ un régime qu’on suivrait docilement s’il était sur une ordonnance ? Entre la nature et la grâce, on peut bien sûr préférer le dosage prudent du cardinal au dosage plus inattendu de Pauline, mais on s’égare en se privant des ressources d’un des deux remèdes. À propos de sa fille Mayline, guérie miraculeusement par l’intercession de Pauline Jaricot, Emmanuel Tran a rapporté à Aleteia cette phrase qu’il aime répéter aux incrédules : “Je n’ai pas le mode d’emploi, mais voici Mayline.” S’il est vrai qu’”une obéissance raisonnable aux médecins est commandée par le Seigneur lui-même”, il est tout aussi vrai qu’un médecin raisonnable ne devrait jamais mépriser les remèdes du Seigneur.