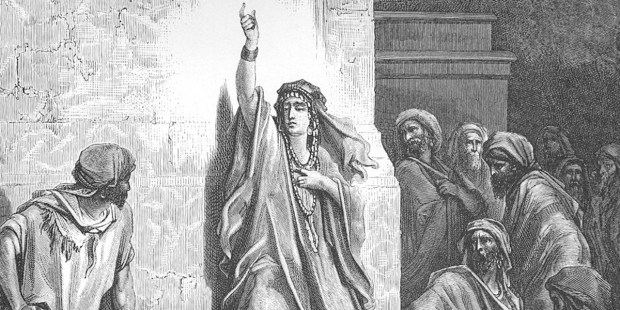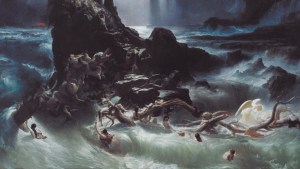« Arrête de faire des jérémiades !».
Voilà une phrase que l’on est souvent tenté de lancer, avec une certaine exaspération, à un enfant qui pleurniche ou à une personne qui se plaint sans cesse et se lamente sur son sort. L’expression “faire des jérémiades” (se lamenter sans fin) dérive de “Jérémie”, nom de l’un des quatre grands prophètes de la Bible. Faut-il en déduire que Jérémie avait une personnalité particulièrement plaintive ? Pas si simple ! Il faut dire que la vie de prophète n’était pas de tout repos.
Jérémie, né au VIe siècle av. J.-C., est très vite appelé par Dieu pour devenir prophète et parler en son nom :
“Ah ! Seigneur mon Dieu ! Je ne sais pas parler, je suis un enfant !” (Jérémie 1, 6).
Les Écritures le présentent comme un homme seul et solitaire qui vit dans le royaume de Juda entre 627 et 587 av. J.-C. À cette époque, Israël se retrouve coincé entre deux grandes puissances : l’Égypte et Babylone.
Un prophète courageux
Contrairement aux prophètes mensongers qui garantissent une fausse paix au peuple, Jérémie n’hésite pas à crier la vérité. Et il le fait quoi qu’il arrive et quoi qu’il lui en coûte. Tâche ingrate et difficile ! Car les hommes n’aiment pas recevoir de mauvaises nouvelles et ont la fâcheuse tendance à en rendre responsable celui qui les annonce. Et lorsqu’il prédit la chute de Jérusalem, chute qui pourrait être évitée avec le repentir du peuple juif et l’urgence de revenir à Dieu et à son alliance, il n’est pas spécialement bien accueilli.
Incompris, haï de tous, persécuté, emprisonné, condamné à l’exil, Jérémie reste malgré tout fidèle à sa tâche car :
“Elle (la parole de Dieu) était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os” (Jérémie 20, 9).
Mais il n’hésite pas à se plaindre à Dieu des malheurs du peuple d’Israël et de la difficulté de sa mission, exprimant parfois violemment son désarroi, voire son désespoir :
“Maudit soit le jour où je suis né !” (Jérémie 20, 14).
D’où l’amalgame avec la personnalité soi-disant plaintive du prophète. L’Histoire donna finalement raison à Jérémie puisque Jérusalem fut détruite par le roi de Babylone en 586 av. J.-C. et sa population déportée.